|
Mon étonnement fut grand lorsque j’ai abordé le nouveau livre de Madame Cynthia Fleury sur la définition de « LA DIGNITÉ » à travers les âges et les divers mouvements sociaux.
Existerait-il plusieurs formes de dignité ?
Cela paraît a priori paradoxal.
Cependant la définition (propulsée par les divers ouvrages académiques) n’est pas très convaincante.
Il est possible que face à cette inintelligibilité de lecture concernant la notion de DIGNITÉ l’autrice de cette étude philosophique se propose d’effectuer un examen des articulations émises entre le signifiant et les différents signifiés du monème précité, articulations variant selon les traditions ethniques, religieuses et/ou sociétales en fonction des époques traversées.
Durant ce voyage, Cynthia Fleury va rencontrer l’antonyme de la dignité et rechercher les écrits et les mouvements qui ont élaboré et essaient encore aujourd’hui d’optimiser des méthodes pour, sinon éradiquer, tout au moins endiguer ce non respect de la DIGNITÉ.
Selon Cynthia Fleury – d’après ce qu’il m’a semblé comprendre – la philosophie des Lumières propose une conception de la DIGNITÉ humaine qui repose essentiellement sur la RAISON et l’intellectualité qui l’étaie.
La RAISON détermine ici la conduite humaine et le concept de DIGNITÉ qui en résulte.
À cette époque les scientifiques détiennent la vérité – par conséquent – la DIGNITÉ les honore.
Cette proposition exclut celle des théologiens du passé selon laquelle toute créature humaine – par essence divine – se trouve naturellement DIGNE d’exister puisqu’elle a été conçue pour participer à la grande aventure universelle indépendamment de ses aptitudes cognitives.
La notion de respectabilité de l’être humain au cœur de ces perspectives divergentes demeure cependant tributaire des mœurs des époques considérées.
Ainsi la DIGNITÉ – concédée à l’être humain – ne semble pas (dans le cadre de ces deux mouvements) engager la notion de RESPECTABILITÉ ce qui apparaît parfaitement paradoxal.
Au 15e siècle Pic de la Mirandole (précurseur des Humanistes) va opter pour une réflexion salvatrice afin de réconcilier ces deux approches : CRÉATURE DIVINE par essence, l’homme serait capable de par sa plasticité de développer sa propre forme pour évoluer grâce à la NATURE qui le sous-tend.
Il rencontre sa DIGNITÉ au croisement de ces deux instances.
Au contraire chez les transhumanistes la DIGNITÉ HUMAINE semblerait s’extraire de la « MÈRE NATURE ».
L’axe de la DIGNITÉ pourrait alors s’infléchir vers un perfectionnement, individuel et/ou collectif quantitatif dirigé vers la recherche de la toute puissance et non plus qualitatif puisque libéré des instances ontologiques de l’Absolu.
Actuellement, en occident, La dignité ne procéderait plus de l’ordre de l’absolutisme érigé par les théologiens du passé, elle ne procèderait pas non plus uniquement de la raison postulée par la philosophie des Lumières.
La nouvelle définition de la dignité de l’être humain, récemment acquise, entre en mouvance avec celle de la respectabilité quel que soit le milieu d’appartenance du sujet ou du collectif considéré.
Ainsi, aujourd’hui, « le Sapiens » a pris conscience de la dignité naturelle de son être de par sa conception qui procède de la création, DIGNITÉ qui s’avère INALIÉNABLE ; par conséquent il exige un partage des valeurs selon son identité qui le définit en tant qu’être humain.
Pour traiter cette question le concept de la « clinique de la dignité » utilisé par Madame Cynthia Fleury pourrait rencontrer celui de « la clinique de l’indignité » afin d’établir « un état des lieux » enregistrant les discriminations de toutes sortes.
D’un point de vue universel : la narrativité noire, les conditions de vie inacceptables des « exilés », les travailleurs citoyens de la propreté qui surgissent de nos « égouts » de toutes sortes, citoyens que les soignants s’évertuent à traiter sans obtenir la considération qu’eux-mêmes aussi mériteraient d’acquérir.
L’effroyable épopée des déplacés…la mésaventure des êtres dévalorisés par l’imprudence et les erreurs des redresseurs de torts issus des instances de la psychiatrie et/ou de la justice, justiciers eux-mêmes tributaires de conditions de travail non régulées, la souffrance des « isolés » qui glissent en silence vers l’espace de l’oubli…sont autant de stigmates qui blessent les victimes leurs agresseurs discrédités et signent la réalité de l’indignité dans nos foyers, nos entreprises, nos villes, colonies et autres sphères de nos diverses sociétés.
La narration de l’indigne dénonçant la notion de non respectabilité devrait permettre aux opprimés de s’extraire de la gangue mortifère dans laquelle ils se trouvent insérés.
Ce travail de reconnaissance de l’indignité pourrait laisser augurer des résultats satisfaisants à long terme, il intègre malheureusement parfois des dérapages incluant des comportements violents indignes et en contradiction avec la cause qu’ils défendent, celle de la RESPECTABILITÉ.
Mais au-delà des individualités, ce sont les sociétés industrialisées ou non qui subissent également le sort de l’indifférence de leur dirigeants politiques eux-mêmes écrasés par le poids de leurs responsabilités qu’ils ne peuvent plus assumer.
L’homme a trahi sa nature et la NATURE qui l’accueille.
IL DEVRA RÉPARER SES ERREURS.
LA CLINIQUE DE LA DIGNITÉ POURRA-T-ELLE ŒUVRER EN CE SENS pour RÉHABILITER l’être humain au sein de l’ordre auquel il appartient ?
Mais je vous laisse lire dans le texte et/ou écouter sur les réseaux les paroles de Madame Cynthia Fleury.
Son étude sur la dignité reste difficilement abordable de par sa complexité.
En ce qui me concerne, je pense que LA DIGNITÉ SYMBOLIQUE INALIÉNABLE de l’être humain déterminée par sa conception reste incontestable elle diffère cependant de celle que nous nous accordons et/ou que les autres nous concèdent.
LA DIGNITÉ INALIÉNABLE RELÈVE DE L’ABSOLU.
La dignité relative s’inscrit au sein de notre histoire dans le « coeur » de chaque être humain face à la résultante des réalités qui le menacent et/ou qui l’encensent.
La dignité relative ne peut rejoindre la DIGNITÉ ABSOLUE qui relève de l’inconnaissable.
Notre statut d’ÊTRE HUMAIN pourrait cependant nous donner accès à la clinique de la RESPECTABILITÉ et de la BIENVEILLANTE RECONNAISSANCE de notre identité humaine commune et par voie de conséquence existentiellement « ESSENTIELLE ».
La clinique de la respectabilité ou de la DIGNITÉ RELATIVE doit-elle émerger de celle de la conscience de l’irrespectabilité pour recenser les actes délétères, les dénoncer et prouver leur irrecevabilité afin de les endiguer en évitant d’utiliser l’irréparable violence physique et/ou psychologique ou bien témoigner directement des nobles réalisations de l’homme afin d’inviter ce dernier dès l’enfance à reconnaître ses PROPRES CAPACITÉS à agir pour le bien de tout un chacun ?
Ces deux procédures ne m’apparaissent pas antagonistes. Les mettre en œuvre au sein de notre système planétaire s’avère – pour l’instant – pratiquement inconcevable.
Selon Monsieur Pierre Lecomte du Noûy.
« Il n’existe pas d’autre voie vers la SOLIDARITÉ que la RECHERCHE et le RESPECT de la DIGNITÉ INDIVIDUELLE. »
C’est bien ce que Madame Cynthia Fleury s’efforce de développer dans cette étude où la définition de la dignité relative rencontre l’éthique du « Care » défini de la sorte par Joan Tronto en 1993 : « activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible » (en respectant la nature) qui nous accueille. Ainsi l’introspection qui pourrait révéler notre DIGNITÉ INDIVIDUELLE INALIÉNABLE ne saurait s’extraire de notre participation active à la réalisation de projets collectifs portant des valeurs « essentielles ».
Les sociétés « réellement démocratiques » seraient encore pour l’instant plus favorables à cet aspect de notre développement.
Le système éducatif des régimes autoritaires et/ou dominants s’efforcerait plutôt de forger des « élites » pour asservir les « outils humains » nécessaires à la maintenance de ces grandes puissances qui élargissent insidieusement leur pouvoir sur l’espace planétaire.
Ce commentaire concernant l’ouvrage très documenté de Madame Cynthia Fleury n’est qu’une simple approche d’une étude qui s’adresse (il faut bien l’avouer) aux gens de lettres ainsi qu’aux scientifiques révélés, ces érudits sauront peut-être effectuer et nous faire partager la synthèse des informations qui nous sont offertes par cette autrice concernant LA DIGNITÉ, concept qui devrait s’inviter dans tous les espaces de nos communautés.
*Pour rappel Madame Cynthia Fleury est une philosophe et psychanalyste française.
Elle est professeure titulaire de la chaire humanités et santé au conservatoire national des arts et métiers et professeure associée à l’école supérieure des mines de Paris, titulaire également de la chaire de philosophie à l’hôpital Sainte-Anne du GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEURO-SCIENCES et également membre du conseil d’administration de l’ONG Santé Diabète ; d’autres titres lui sont également attribués, la liste des distinctions susnommées n’est pas ici exhaustive.
|

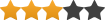
 (3 / 5)
(3 / 5)